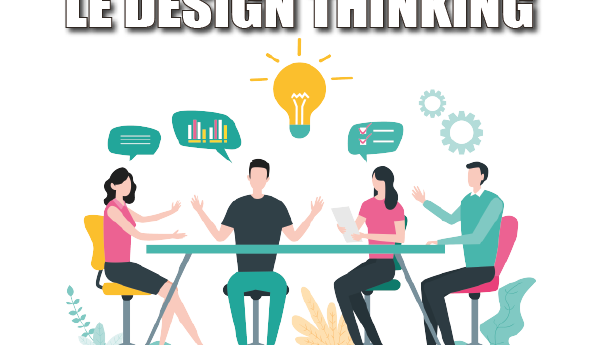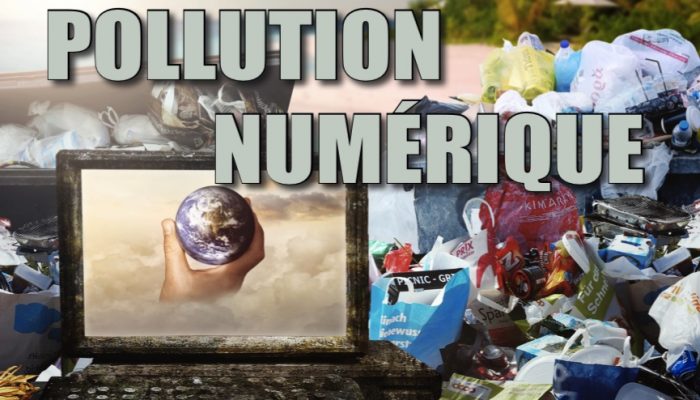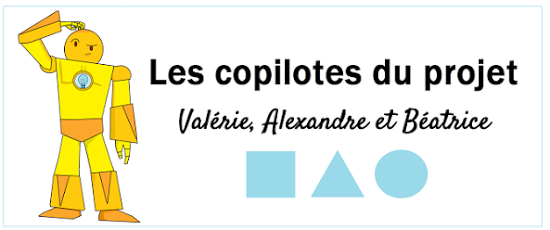Chers lecteurs,
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le septième numéro de Didak’tic, entièrement dédié aux expériences virtuelles qui se jouent entre les frontières complexes de la fiction et de la réalité.
Dans ce monde en constante évolution où les avancées technologiques révolutionnent notre quotidien, il est essentiel de comprendre et d’analyser les implications de ces nouvelles formes d’interaction.
Ce numéro explore en profondeur deux domaines clés qui repoussent les limites de notre perception : la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV).
Avec l’évolution fulgurante des jeux vidéo, ces technologies s’imposent comme des outils révolutionnaires, offrant des expériences immersives et captivantes. Nous vous emmènerons dans le monde envoûtant des jeux vidéo, où la réalité se mêle à la fiction, transformant nos émotions et notre façon d’appréhender les récits interactifs.
Mais au-delà du divertissement, la RA et la RV transforment également l’industrie culturelle. Des musées aux expositions, en passant par les événements artistiques, ces technologies permettent de transcender les limites physiques, créant de nouveaux espaces d’expression et de découverte. Nous explorerons l’impact de ces avancées sur notre patrimoine culturel et les opportunités qu’elles offrent pour préserver et partager notre héritage.
La santé est également au coeur de cette révolution numérique. La e-santé, avec ses applications en réalité augmentée et virtuelle, ouvre de nouvelles perspectives dans les soins et la réadaptation. Nous examinerons comment ces technologies permettent aux professionnels de la santé d’améliorer leurs diagnostics, de faciliter les traitements et d’optimiser les résultats pour les patients.
Les domaines de métiers à risques, tels que l’aviation, l’armée ou encore l’industrie du nucléaire, peuvent bénéficier de simulations virtuelles pour s’entraîner dans des environnements dangereux. Ces technologies révolutionnent la formation professionnelle et contribuent à assurer la sécurité.
Enfin, nous ne pouvons pas ignorer les bouleversements sociétaux provoqués par la RA et la RV. Les frontières entre la réalité et la virtualité s’estompent, entraînant des défis juridiques et éthiques complexes. Comment réguler ces technologies pour garantir la protection de la vie privée, prévenir les abus et maintenir une coexistence harmonieuse entre le monde réel et le monde virtuel ?
Ce numéro de Didak’tic a pour ambition de vous éclairer sur ces enjeux majeurs qui redéfinissent notre perception de la réalité. Nous espérons que ces articles soigneusement sélectionnés par notre équipe vous offriront des clés de compréhension et vous inciteront à penser avec nous les implications de ces
avancées technologiques.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les auteurs qui ont contribué à ce numéro et qui ont partagé leurs connaissances et leurs perspectives. Leurs articles vous guideront dans un voyage fascinant au coeur des expériences virtuelles.
Bonne lecture à tous et n’oubliez pas de rester curieux !
L’éditorial que vous venez de lire a en grande partie été rédigé à l’aide de Chat GPT. En effet, les sujets traités dans ce numéro ne sont pas les seuls à révolutionner nos environnements numériques. Depuis novembre 2022, Chat GPT, un prototype d’agent conversationnel mis au point par OpenAI, est mis à disposition du grand public. Des copies d’examens à la simple conversation, du code informatique jusqu’au calcul mathématique, ce sont tout un tas d’actions normalement réalisées par l’être humain, qui peuvent maintenant être accompagnées par cette machine intelligente. Nous nous sommes alors demandés: « Et si Chat GPT pouvait rédiger lui-même une partie de cette revue ? ».
Nous espérons que ces quelques lignes vous ont permis d’amorcer votre voyage au cœur du virtuel, un monde où fictions et réalités s’entremêlent.
Bonne lecture !
Yoh’Anan Baude, Marine Brignon, avec la participation de Chat GPT.
La désinformation, fléau du web
Chers lecteurs,
« Les animaux sont vecteurs de propagation de la Covid-19 ! », « Porter un masque ne sert à rien ! », ou « Il est très important de porter un masque pour se protéger du virus ! » : voici le genre de discours paradoxaux que nous pouvions entendre durant les prémices de la pandémie que connaît le monde depuis 2019.
Cette dernière a permis à un phénomène d’occuper de nouveau le devant de la scène : la désinformation, véritable fléau à l’ère du numérique.
Les périodes de confinement exceptionnelles qu’a subi le monde entier à cause de la propagation du virus ont fortement contribué à la circulation de la désinformation et de « fake news ». Perçus alors comme un lien privilégié avec l’extérieur durant cette période hors du commun, les réseaux sociaux sont devenus pour beaucoup leur principale source d’information, bien trop souvent erronée.
Qu’est-ce que réellement la désinformation et pourquoi est-elle considérée comme un fléau ?
Dans ce sixième numéro de Didak’TIC, nous approcherons cette problématique sous un angle politique, historique mais aussi psychologique.
En effet, c’est lors de la campagne d’élection présidentielle américaine de 2016 que fut abordé pour la première fois le caractère dangereux des fake news, expression lancée à l’époque par le candidat Donald Trump via son compte Twitter. La désinformation entretient depuis une relation étroite avec la politique et les pratiques médiatiques relatant les faits politiques au point de devenir une menace pour la démocratie.
Proportionnelle à l’invasion du numérique dans notre quotidien, la désinformation est plus présente que jamais. Disséminée principalement par les réseaux sociaux, elle poussa plusieurs acteurs influents tels que Twitter ou Facebook, dont la responsabilité est engagée, à se mobiliser contre sa propagation, à lutter contre les fake news.
Néanmoins face au volume exponentiel d’informations diffusées et partagées quotidiennement, la désinformation ne cesse de gagner du terrain. En témoigne l’inquiétante remise en cause du réchauffement climatique résultant de la décrédibilisation de la parole scientifique qui s’explique notamment par une communication erronée et hâtive des médias.
Il nous a donc semblé plus que nécessaire de consacrer ce nouveau numéro à la désinformation afin, dans un premier temps, de sensibiliser sur les méfaits qu’elle occasionne. Dans un second temps, nous mettons l’accent sur des pistes de solutions à envisager et de bonnes pratiques à adopter en vue d’une meilleure compréhension et reconnaissance de ce phénomène dans l’objectif de lutter efficacement contre sa propagation.
Léonie FLEURY
« FAIR » de l’open data un enjeu
Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette année, nous avons décidé de vous faire voyager au cœur de la donnée, de cette information qui circule et se partage.
Si l’open science favorise et encourage ce mouvement, ce dernier n’est pas anarchique et doit se « FAIR » dans le respect de certaines règles et grâce à des moyens mis à la disposition des chercheurs.

Comprendre pourquoi l’open data
Les données ouvertes sont, comme l’indique leur nom, des données numériques, d’origine privée ou publique, laissées libres d’accès et d’usage.
Elles sont généralement produites par un établissement public ou une collectivité. Les notions de bien commun et de droit d’accès à l’information s’inscrivent au travers de ce mouvement d’open data.
Au-delà de cet aspect philosophique, l’intérêt de l’ouverture et du partage des données de la recherche est multiple. La visibilité des travaux des chercheurs est augmentée, favorisant ainsi la notoriété scientifique. L’ouverture des données favorise également l’évaluation par les pairs et apporte de l’intégrité
aux résultats des recherches.
De plus, dans ce domaine qu’est la recherche où l’aspect financier est primordial, la réutilisation des données permet une rentabilité accrue et un gain de temps dans l’étude menée. Pour finir, l’autre raison poussant vers l’adoption de l’open data est que ce libre accès et la diffusion des données de la recherche peut amener des chercheurs à développer d’autres théories et ainsi aboutir à découvrir autre chose que ce qui était recherché. En d’autres termes, l’open data favorise la sérendipité.
Favoriser l’open data, oui mais pas n’importe comment
De la publication scientifique, à l’entrepôt de données, en passant par les TGIR, de nombreux moyens sont mis à la disposition des chercheurs pour partager leurs données. Cependant, des règles sont à respecter et de bonnes pratiques à adopter.
Que ce soit le RGPD pour protéger les données à caractère personnel, ou bien encore la mise en œuvre d’un plan de gestion des données, en passant par le stockage dans des entrepôts de « confiance », des lignes directrices existent afin de « FAIR » de l’open data un principe de la science ouverte à adopter par tous. Au-delà de leur partage, ces principes ont également pour but de pérenniser l’exploitation, et la réexploitation, de l’information qu’elles véhiculent.
Une ouverture illusoire
Mais ne nous leurrons pas chères lectrices et chers lecteurs, toutes les données ne peuvent (ou ne doivent ?) pas être partagées et encore moins réutilisées. La crise sanitaire du SARS-COV 2, et le débat autour du statut du brevet comme bien commun de l’humanité, en est un parfait exemple. Si la question ne se pose pas pour
les données de la recherche issues de fonds publics, celle résultant de financement privés, ou de recherches « sensibles », reste soulevée.
Mais finalement, la vraie question n’est-elle pas plutôt de se demander s’il est nécessaire de tout partager ? Et surtout de tout réutiliser…
Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce flot de données que sont les articles de ce nouveau numéro de la revue des étudiants du Master MAVINUM et que nous partageons avec vous avec plaisir.
Bonne lecture.
Nadia NEMER-BRUN
Le Design Thinking : une innovation centrée sur l’utilisateur
Chères lectrices, chers lecteurs,
Si le terme Design thinking vous semble récent, c’est parce qu’il l’est. Apparu à la fin du XXème siècle, ce processus a longuement été utilisé dans le cadre de la création. En effet, cette notion de créativité est au cœur même du concept, puisque ce sont les créatifs
qui l’ont inspiré. Designers, graphistes, artistes sont les pionniers de ce qui représente aujourd’hui les différentes étapes du Design Thinking.

Comprendre le Design Thinking
Le Design Thinking désigne une méthode par laquelle une entreprise, un designer ou un scientifique va essayer d’innover. De créer quelque chose de nouveau à partir d’usages pré-existants ou en les réinventant.
Le produit qui résulte de ce parcours dispose néanmoins d’une particularité : il est centré-utilisateur. Ce terme très actuel signifie tout simplement que la chose a été créée, imaginée, testée en concertation à chaque instant avec son futur utilisateur.
Loin d’être limité à la vente d’un produit ou d’un service, le Design Thinking se décline dans tous les domaines. Un utilisateur est à ce titre autant un étudiant comme usager de son Université, qu’une adhérente à une association humanitaire.
Tout peut être rendu plus optimal, plus utilisable
, si on se concentre sur le destinataire, ses attentes, ses besoins et ses frustrations
Mettre en oeuvre le processus
Tout d’abord, il est important de comprendre que la méthode intervient au début de la conception d’un produit – c’est-à- dire à la phase d’innovation. Le processus se compose de cinq étapes clés : les phases d’empathie, d’analyse et définition, d’idéation, de prototypage et de test.
Dès la première étape, on s’intéresse à l’utilisateur et à l’existant. Pour cela, des outils sont à disposition pour permettre d’être guidé tout le long de la méthode. On compte par exemple le brainstorming
, le partage d’expérience, le benchmarking
, le Mindmap
, l’observation, le Storyboard
, etc…
Chacun de ces outils permettent d’appréhender au mieux les besoins de l’utilisateur, pour les analyser et créer à partir de ceux-ci.
Une méthode sujette à question
Bien qu’elle semble prometteuse, cette méthode ne fait pas encore l’unanimité
Cette année, les étudiants du Master 2 Management et Valorisation de l’Information Numérique ont décidé de s’emparer du sujet, pour comprendre de quoi il en retourne.
Ainsi, les articles de ce numéro sont allés interroger la place du Design Thinking dans différents milieux, pour mieux être capable de l’appréhender. Pour ce faire, quatre catégories se sont distinguées d’elle-même : l’innovation, l’entreprise, l’expérience utilisateur, et les sciences et la recherche
Nous espérons que nos articles vous apporteront de précieuses informations, et nous vous souhaitons à tous une bonne lecture.
Caroline RICCIARDI
Zoom sur la pollution numérique…
Chers lecteurs,
L’origine de l’épuisement des ressources et du réchauffement climatique est plurifactorielle. L’un des coupables semble pourtant relativement absent au banc des accusés, il s’agit du numérique. Alors que son développement a de plus en plus d’impact sur notre société, la question de la pollution numérique devient un véritable enjeu écologique.

La pollution numérique, qu’est-ce que c’est concrètement ?
Dans ce troisième numéro Didak’tic, nous aborderons cette question sous l’angle de l’impact environnemental du numérique, de la donnée et de l’information numérique.En effet, encore méconnue du grand public, la pollution numérique est un phénomène bien réel lié aux usages (internet des objets, e-mails, requêtes sur les moteurs, vidéos en ligne, applications, des smartphones….), aux supports de l’information (fabrication, utilisation, fin de vie des terminaux, data centers…), à l’explosion du volume et du trafic des données mais aussi aux blockchains et au tracking publicitaire.
Le numérique est donc en pleine explosion depuis une vingtaine d’années, tant au niveau logiciels et emplois. C’est un secteur en pleine mutation qui génère un marché très florissant. En effet, le numérique est omniprésent dans notre quotidien notamment par l’usage d’internet et des objets connectés, nous contribuons ainsi souvent sans le savoir à cette pollution numérique. Force est d’admettre qu’il est trop tard pour revenir en arrière, le numérique ayant déjà considérablement transformé nos habitudes et pratiques personnelles et professionnelles.
Toutefois, il nous semble nécessaire d’avertir sur les dangers inhérents à cette pollution numérique, d’éclairer sur les sources les plus polluantes et partager les bonnes pratiques pour limiter leurs impacts.
Dans un même temps, l’empreinte carbone du numérique ne cesse de croître. Face à ce fléau, des solutions, à petites et grandes échelles, existent. Des modifications du comportement des internautes à l’éco-conception, en passant par l’investissement dans les énergies vertes, nous verrons comment il est possible d’adopter une démarche numérique responsable.
Pour sensibiliser un large public à cette pollution dite invisible et inciter chacun d’entre vous à réduire l’impact lié à cette pollution, ce nouveau numéro tente d’informer, d’alerter sur les conséquences et les enjeux de la pollution numérique. Car, malgré tous les efforts de sensibilisation à cette pollution consentis par les différents acteurs du numérique responsable, de réels progrès restent à faire, demandant la mobilisation des différentes institutions: publiques, entreprises, associations spécialisées, des consommateurs….afin de proposer des pistes d’amélioration en vue d’une plus grande sobriété numérique.
Lydia HADJERES et Maeva CAMUS
Science Ouverte, faire sauter les verrous !
Un Plan national pour la Science Ouverte a été dévoilé le 4 juillet dernier par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Frédérique Vidal. Ce plan reprend les préconisations formulées par l’Union européenne dans l’Amsterdam Call for Action on Open Science en 2016. Mais qu’est-ce que la Science Ouverte ? La Science Ouverte est un mouvement international qui défend l’idée que la science est un bien commun et qui encourage donc « une approche transversale de l’accès au travail scientifique, des visées du partage des résultats de la science mais aussi une nouvelle façon de FAIRE de la science en ouvrant les processus, les codes, les méthodes » (DIST-CNRS, Livre blanc – Une Science ouverte dans une République numérique, 2016). L’idéal d’une Science Ouverte se concrétise petit à petit grâce à des politiques publiques en faveur de l’Open Access. L’expression « Open Access » peut être traduite en français par « libre accès à l’information scientifique et technique ». L’objectif du mouvement de l’Open Access est de « rendre accessible gratuitement, en ligne, toute production issue d’un travail de recherche » (ENSSIB, 2012). Une Science Ouverte, c’est donc faire en sorte que les publications scientifiques et les données de la recherche soient ouvertes « à tous, chercheurs, entreprises et citoyens, sans entrave, sans délai, sans paiement » (Plan pour une Science Ouverte). Une Science Ouverte est censée avoir des retombées positives tant pour la recherche et les chercheurs que pour la société toute entière. Mais les obstacles à surmonter sont encore nombreux.
Dans ce second numéro de Didak’TIC, nous commençons par définir l’information scientifique et technique (IST) et par présenter des acteurs de l’IST encore trop souvent méconnus : les URFIST. Ensuite, nous vous proposons un dossier qui revient sur les principaux enjeux de l’Open Access (page 13). L’Open Access, en ce qui concerne les publications des chercheurs, n’est plus à présenter et est aujourd’hui bien installé dans le paysage de la recherche française, notamment avec HAL – qui compte parmi les principaux réservoirs mondiaux de contenu IST –, et avec l’émergence de nouveaux modèles de publication comme les épi-revues. En 2016, l’article 30 de la loi pour une République numérique est venu renforcer la dynamique de l’Open Access en France, inscrivant dans la loi les recommandations de l’Union européenne en la matière. Cependant, même si le modèle encore prépondérant de l’abonnement est en déclin, les grands éditeurs commerciaux ont plus d’un tour dans leur sac et ne sont pas prêts de dire adieux à leurs profits colossaux ! En effet, ceux-ci investissent depuis quelques années la voie dorée en proposant un modèle économique auteur-payeur très lucratif que nous détaillerons. Notre deuxième dossier est centré sur les données de la recherche (page 39). Celles-ci ont pendant longtemps été négligées et ce n’est que récemment que l’on a pris la mesure de leur valeur pour la science. Leur préservation, leur gestion, leur partage et leur réutilisation constituent un nouvel axe de l’Open Access. Il est essentiel d’éviter que le phénomène d’accaparement des publications scientifiques par les éditeurs ne se reproduisent avec les données de la recherche. En France, la loi pour une République numérique a donc cherché à les protéger de l’avidité des grands éditeurs commerciaux. La diffusion et la réutilisation des données de la recherche ouvrent des perspectives nouvelles à la science et viennent modifier en profondeur les pratiques des chercheurs qui ont besoin d’être accompagnés.
Mais pourquoi avons-nous choisi de vous parler cette année du thème de la Science Ouverte ?
En tant que futurs professionnels de l’information et de la documentation, le mouvement de la Science Ouverte nous concerne tout particulièrement car :
- Les professionnels de l’information et de la documentation ont eu un rôle politique de premier plan dans le mouvement de l’Open Access et ont encore un rôle politique déterminant à jouer pour permettre sa généralisation et l’avènement d’une ère de la Science Ouverte.
- Les professionnels de l’information et de la documentation, de par leurs compétences, ont un rôle de médiation documentaire à jouer.
Les réservoirs en information scientifique et technique en libre accès sur internet se multiplient, ce qui crée un phénomène de fragmentation du savoir. C’est là que les bibliothèques universitaires (BU) jouent un rôle de « passerelle vers les ressources électroniques » (Barthelemy et al,2016).
Les bibliothécaires localisent les archives ouvertes et les revues en Open Access qui sont en adéquation avec les besoins du public de la BU, les signalent dans le catalogue et les valorisent. - Enfin, les professionnels de l’information et de la documentation ont une fonction d’aide et de support technique. L’Open Access rend nécessaires leurs compétences et est venu renouveler leurs missions. Ils accompagnent les chercheurs lorsqu’ils déposent leurs publications dans des archives ouvertes, ils permettent le suivi bibliométrique, ils numérisent et indexent des corpus, ils créent des bases de données et effectuent la maintenance des entrepôts institutionnels.
Comme l’explique le rapport « Moving towards an Open Access future : the role of academic libraries » publié en 2012, avec le développement de l’Open Access, le professionnel de l’information a un rôle de premier plan.
En effet, l’apport des BU reposera de moins en moins sur leur fonds mais dépendra plutôt des services et de l’accompagnement qu’elles fourniront aux étudiants et aux chercheurs : « Le professionnel de l’information sera la bibliothèque de demain ».
Sonia SALAMI, Constance PICQUE et Cédric MARION.
Au delà des frontières temporelles, territoriales, culturelles et professionnelles : la construction de connaissances !
Cher monde de l’information,
Comment introduire un premier numéro ?… Nous réfléchissons en séance de visio, nous, les copilotes du projet, autour de cet exercice qui pourrait paraître anodin après toutes les étapes franchies : écrire un éditorial. Et là, la lumière : quel a été notre postulat de base à l’initiative de ce magazine ? Le Big Data… Ces deux mots que beaucoup peinent à comprendre. Ces deux mots qui effraient certains. Ces deux mots que nous-mêmes avions du mal à expliquer SIMPLEMENT. Nombre de personnes clament d’emblée : “je ne comprends pas, c’est de l’informatique”, “je ne comprends pas, c’est trop technique” “Big Data : kesako ?”. Réaction légitime et humaine face à cette tempête qui engendre de vrais changements.
Mais de quoi s’agit il exactement ? Est-ce un effet de mode ? Un nouveau mode de calcul de probabilité ? Pourquoi s’y intéresser : quels enjeux, quelles opportunités ? Quels impacts dans notre quotidien, dans les entreprises et les organisations ? Quels nouveaux concepts accompagnent ce paradigme ? Datastorelling, crowfunding, machine learning : tant de terminologies “barbares” qui rebutent tout un chacun.
Dans ce monde complexe, la variété et la quantité d’informations, trop souvent mises à la disposition du public sous le seul angle technique, nous avons décidé d’amorcer un dispositif pouvant combler ce manque d’accompagnement au savoir. Bien des enjeux nous concernent tous pourtant ; certains sont très accessibles !
A travers ce magazine, nous souhaitons, par conviction, apporter des réponses claires, simples et concises aux sujets complexes qui nous entourent.
C’est aussi, par passion de transmettre ce que nous avons appris tout au long des enseignements de master.
C’est également par obligation de réaliser un projet universitaire et, soyons honnêtes, viser une bonne évaluation ! 🙂
Quoi qu’il en soit (ou quelles que soient nos motivations profondes), la mise en oeuvre de ce projet a mis en évidence qu’un professionnel de l’information ne connaît plus de frontière, ni temporelle ni géographique ! De tout âge, de sensibilité différente quant à la fonction et aux métiers de l’information, des quatre coins de la planète, telle fut notre équipe.
Ce projet a su surmonter de nombreux challenges, bravant ainsi décalages horaires, vies professionnelles et familiales en parallèle. Il est une Superbe illustration de l’évolution de notre époque en terme de culture numérique sur les modes de travail et de gestion de projet 2.0.
Mais le challenge ne résidait pas seulement là. ll fallait également concrétiser un projet qui nous rassemble et nous ressemble. Alors quoi de mieux que de mettre en place un magazine et un site Internet à notre image et nous permettre pour une fois de laisser une trace concrète de notre collaboration !
Ce projet nous a apporté l’interdisciplinarité qui caractérise si bien les Sciences de l’Information et de la Communication. Cessons de voir le monde en silos et partageons nos connaissances !
Ce projet nous a fédéré, ce projet nous a rassemblé, ce projet nous a professionnalisé.
Alors partagez avec nous, ce fabuleux voyage ! Le premier d’une série que feront vivre les futures promotions des MAVINUM qui vous proposeront d’autres études de fond sur des sujets autour du Management et valorisation de l’information numérique.